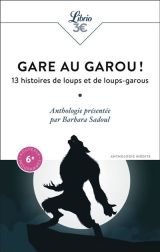Gare au garou ! regroupe 13 nouvelles et extraits qui explorent les limites entre l’humain et la bête, des contes d’Ésope au théâtre de Barbara Sadoul. Il ne s’agit pas là de la première incarnation de cette anthologie, qui a été publiée en 2000 sous le même titre et un sommaire quelque peu différent. La directrice d’ouvrage est également loin d’en être à son coup d’essai : le loup-garou était son sujet de doctorat, et elle a édité au moins une autre anthologie sur cette figure fantastique : Le Bal des loups-garous (1999). Le remaniement de la sélection d’origine est sans doute lié à la mise au programme du thème pour le niveau sixième : en atteste un macaron sur la couverture et le matériel additionnel présent à la fin du livre. Mais pour un néophyte comme un spécialiste, que vaut la sélection de textes ?
Gare au garou ! propose d’explorer les interactions entre le loup et l’être humain. De fait, il n’est pas toujours question de transformation, mais du rapport de l’homme à la bête et à la peur qu’elle inspire. « Le berger mauvais plaisant » attribué à Ésope qui ouvre l’anthologie est dans cette optique. On est en présence d’une faible moralisatrice, où l’expression « crier au loup » trouve ses racines.
« Lycaon » d’Ovide met aux prises un aristocrate humain qui se croit supérieur aux Dieux, et se retrouve confronté à Jupiter sous les traits d’un mendiant. Lycaon — qui projette d’assassiner son hôte — lui offre à manger de la chair humaine. Ce qui lui vaudra le courroux du dieu, lequel le transforme en créature mi-homme, mi-loup : le statut de Lycaon est une malédiction. Dans le même temps, la rage intérieure du personnage est ainsi extériorisée. Jupiter, persuadé que les hommes ne sont pas des êtres dignes, déclenche le déluge sur le monde, proposant de donner vie à une nouvelle humanité.
Barbara Sadoul fait se succéder à ces deux premiers récits un extrait du Satyricon de Pétrone. Le texte commence à dessiner l’imagerie de la créature, conscience ici de ce qu’elle est. Le garou sentant sa transformation arriver se dévêt, et la blessure infligée à son moi bête est visible quand il redevient lui-même. On flirte également avec l’idée du loup déguisé en agneau : jusque-là, l’homme atteint évolue au su et à la vue de tous, sans que personne ne se doute de ce qu’il est.
S’ensuit ce qui est sans doute un des récits les plus fascinants de l’anthologie : le lai (poème) « Bisclavret » de Marie de France, daté du XIIe siècle. Un texte qui imagine une créature qui n’est pas foncièrement maléfique. Le protagoniste a conscience de son état, et c’est en se confiant à sa femme qu’il signera (un temps) sa perte. Le personnage-titre n’attaque pas forcément les hommes : uniquement ceux qui lui ont fait du tort. On retrouve également certaines idées du texte de Pétrone, notamment le thème du personnage qui se dévêt et dissimule ses vêtements durant sa phase lycanthropique. La créature est ici utilisée dans le cadre d’un récit d’adultère : elle représente le mari trompé qui finira par se venger.
« Le loup et l’agneau » (1668) de Jean de la Fontaine prend la suite. On s’éloigne là des histoires précédentes pour revenir à la fable d’Ésope. C’est bien un loup (et pas une créature hybride) dont il est ici question. Pour autant, le texte interroge le rapport entre l’homme et la nature, entre le domestique et le sauvage. Il y a donc une certaine logique à la faire figurer ici. Dans le même temps, on recroise aussi l’un des thèmes chers à la morale de La Fontaine : l’idée d’une justice aveugle, celle du plus fort.
Avec « Le petit chaperon rouge » (1697) de Charles Perrault, on ne retrouve pas directement le motif de la lycanthropie, mais on est bel et bien en présence d’un loup capable de raisonner face à l’homme (et d’échanger oralement avec celui-ci). Le texte joue avec la duplicité supposée de l’animal, dont l’instinct est porté par sa faim. Une fois de plus, on recroise le thème du loup dans la bergerie, avec une bête qui se grime en être humain pour s’attaquer aux plus faibles. Si dans d’autres versions, le loup finit tué, ce n’est pas le cas chez Perrault, où il dévore autant la grande mère que la petite fille. Il y a une certaine logique à faire figurer ce texte après celui de la Fontaine : on reste dans une dimension moralisatrice.
L’animal rejoint le monde romanesque avec le récit suivant, en réalité un extrait du « Meneur de loup » (1857) d’Alexandre Dumas. À nouveau, il ne s’agit pas directement d’un loup-garou, mais bien d’un loup doué de raison. Pour autant, le personnage est capable de marche sur ces deux jambes, et de parler avec les humains. L’histoire exploite le thème du pacte avec le diable, et le loup y est présenté comme un émissaire de celui-ci.
Guy de Maupassant prend la suite avec « Le Loup » (1882). Comme chez Dumas, le cadre du récit est celui de la chasse. On est ici dans une optique assez proche du texte de la Fontaine : deux frères grands amateurs de chasse feront face (tragiquement) au loup, personnification d’une nature cruelle contre laquelle l’homme est démuni.
Avec « Le gâloup » (1965) de Claude Seignolle, on est bien en présence d’une créature mi-homme mi-animal. Le romancier français convoque le motif du « je est un monstre », qu’Anne Rice popularisera pour une autre créature avec son Entretien avec un vampire (1976). Seignolle s’approprie l’idée de l’opposition entre l’animal et l’homme, entre le jour et la nuit (et donc le diable). Face à ce loup qui décime leurs troupeaux, les hommes sont ivres de vengeance. Mais la créature ne serait-elle pas l’un d’eux, comme le dit l’ancien ?
« Loup-garou » (1992) de Bernard Friot reprend à son compte le « crier au loup » cher à Ésope. Personne ne paraît vouloir croire ce petit garçon quand il arrive en classe en expliquant avoir vu une créature mi-homme mi-loup, la nuit passée. La chute est plutôt bien vue, et change des poncifs habituels avec la fable originale.
L’avant-dernier texte est un extrait du Prisonnier d’Azkaban (1999) de la saga Harry Potter, de J. K. Rowling. Un choix qui permet de montrer que le loup-garou a depuis intégré le monde de la fantasy urbaine, et qu’il évolue de consort avec d’autres créatures fantastiques : sorciers, etc. Dans le même temps, on y retrouve la peur suscitée par la créature qui se transforme et perd la maîtrise de son humanité.
Le recueil s’achève sur un extrait remanié par l’auteur de sa pièce Vampirette et sortilèges. Ici, le loup-garou est la tante de l’héroïne, une jeune vampire qui découvre ce qu’elle est. Le personnage du garou y apparaît comme un garant de la séparation entre les mondes, au grand damn de la petite fille qui elle ne veut pas rompre avec la vie humaine qui a été la sienne jusque-là.
Un recueil relativement varié, qui explore différents aspects des liens qui unissent homme et loup depuis des temps immémoriaux.