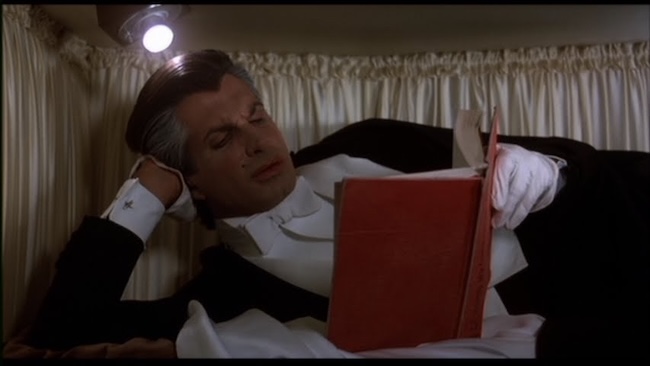Rien ne va plus pour Dracula : le vampire est contraint de fuir la Transylvanie, son château ayant été réquisitionné par le pouvoir communiste pour être transformé en centre d’entraînement pour gymnastes. Accompagné de son inséparable Renfield, le comte décide d’émigrer à New York, avec l’espoir de rencontrer la top model Cindy Sondheim. Pour lui, il ne fait aucun doute qu’elle est la réincarnation de celle qui a partagé plusieurs fois sa vie au cours des siècles passés. Mais Jeffrey Rosenberg, le psychiatre et petit-ami de Cindy (et accessoirement descendant de Van Helsing) risque fort de ne pas l’entendre de cette oreille.
Dracula : Love at first bite (en VF : Le vampire de ces dames) est une comédie basée sur un scénario de Robert Kaufman, sur une idée de l’acteur George Hamilton. L’histoire ne suit pas le roman de Bram Stoker même si elle en convoque de multiples personnages et éléments tirés de ce dernier. Dès les premières images, le fait que Dracula a survécu aux attaques de Van Helsing est mis en scène, soulignant les capacités d’adaptation à toute épreuve du personnage. Si le film suit le vampire qui va s’établir loin de sa terre natale, c’est ici sous la contrainte : le régime politique en place prend possession de son château. Les créatures de la nuit se sont établies depuis le début des années 1970 aux États-Unis, à partir de Count Yorga. Il était donc logique que Dracula finisse par emprunter cette direction. De quoi confronter le protagoniste avec les réalités du New York de l’ère Disco. Même si le vampire dégage quelque chose de suranné (ne serait-ce que par son costume ou sa diction), il se prend finalement au jeu de ce nouveau territoire, qui lui offre des possibilités inattendues. Mais le comte doit aussi se faire une raison : face aux affres du monde contemporain, il ne fait plus peur.
Sous ses atours de comédie, le film s’intègre efficacement dans la généalogie des longs-métrages mettant en scène la figure du vampire. On y retrouve l’idée d’un Dracula à la recherche d’un amour perdu et réincarné (l’influence du Dracula de Dan Curtis), autant que des clins d’œil appuyés au film de Tod Browning (le rire de Renfield, qui rappelle l’incarnation du personnage par Dwight Frye), en passant par Le Bal des Vampires (la scène de danse en boîte de nuit est indubitablement un hommage à celle du bal dans le Roman Polanski). Et si l’ensemble n’est pas une adaptation du livre, on y croise néanmoins un descendant de Van Helsing, qui campe un antagoniste en mal d’efficacité face au comte. Leur opposition permet de convoquer l’attirail complet des méthodes pour s’attaquer aux vampires. Et Dracula de s’imposer en spécialiste : force est de constater que les techniques peinent à faire effet, quand elles ne fonctionnent tout simplement pas (les balles en bois, destinées au loup-garou). L’époque contemporaine donne au scénariste l’occasion d’introduire des idées depuis devenues des incontournables des films sur le thème. Ainsi les banques de sang, réserve inépuisable pour les vampires, qui ouvrent tout un éventail de possibilités : ils ne sont plus obligés de tuer pour assouvir leur besoin de sang.
Le Vampire de ces dames est un long-métrage qui joue avec efficacité sur son sujet, autant pour se moquer d’une vision ampoulée de ce dernier que pour démontrer que l’avenir du vampire n’est plus (pour le moment) au face-à-face sempiternel avec le chasseur. Le final, où le comte discute avec celle qui a accepté d’être transformée (et donc de vivre éternellement à ses côtés) vient en rupture avec la mort — habituellement attendue — du vampire.