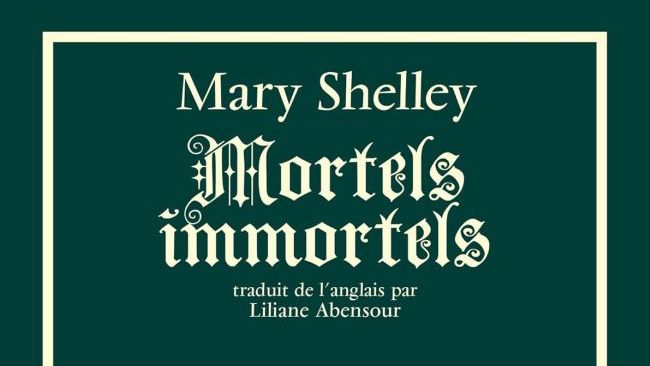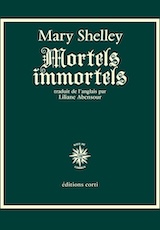On connaît surtout (voir quasi exclusivement, en France) Mary Shelley pour avoir été l’autrice de Frankenstein. Mais l’œuvre de la femme de lettres est loin de se limiter à ce seul ouvrage. Mortels Immortels nous permet de découvrir une autre facette de la romancière : son travail de nouvelliste. Le recueil des éditions José Corti propose ainsi trois textes courts, publiés plus de dix ans après Frankenstein. Entre-temps, la jeune femme a perdu un enfant en couche, et Percy Bysshe Shelley — son époux depuis 1816 — s’est noyé. Autant de raison d’exorciser les questions de deuil et d’obligations familiales par la plume ? Ajoutons par contre que le terme nouvelle (short story en anglais) — dans le sens texte de fiction court destiné à un public adulte — n’existe pas sous cette définition avant 1880, en Angleterre.
« L’endeuillée » (« The Mourner », 1829) est ainsi le premier récit du livre. Le personnage central, marié depuis peu, se confie à son épouse lorsqu’il l’emmène se recueillir sur une tombe sans nom. Là, il lui raconte l’histoire d’Ellen Burnet, une femme qui a compté pour lui, à une époque où il était ostracisé par ses pairs. Ellen, qu’il rencontre durant une fugue, devient un phare dans son existence. Il finit néanmoins par découvrir la part d’ombre de la jeune femme. Le décès de son père, survenue alors que tous deux étaient passagers d’un bateau, pèse sur le personnage. Les conditions de cette mort et le deuil qu’elle n’est jamais parvenue à surmonter résonnent avec l’histoire de l’autrice. À ce titre, difficile de ne pas voir Ellen Burnet comme un avatar de celle-ci. Il ne s’agit pas d’un texte surnaturel : le thème du décès y est omniprésent, mais on est clairement dans une veine romantique : le sublime cher à Burke est tangible dans les descriptions de la nature.
« Le rêve » [« The Dream », 1831] est présenté par l’auteur comme une courte légende d’origine française. L’histoire raconte les questionnements d’une jeune héritière dont le père et les frères sont morts durant le conflit entre protestant et catholique qui accompagne l’accession au trône d’Henri IV. Constance de Villeneuve est éprise depuis des années d’un chevalier dont la parentèle [voire lui-même] est impliquée dans le décès de sa famille. Hésitant à tourner la page — et épouser celui à qui elle a fait ses vœux — ou rentrer en religion, la comtesse décide de s’en remettre à Saint Catherine. Il s’agit pour elle de passer une nuit au bord du précipice, allongé dans un espace décrit comme la couche de la Sainte : si elle survit, Dieu bénit son union. Le récit possède plusieurs éléments récurrents de la fiction gothique : la présence de fantôme, les amours contrariés entre deux protagonistes centraux et l’importance des rêves. Et dans le même temps, l’autrice revient au thème du deuil, aux questions qu’il soulève pour les survivants [aller de l’avant ou s’enfermer dans le chagrin].
« L’Immortel mortel » [« The Mortal Immortal », 1833] est le dernier texte du recueil, et celui qui lui donne son titre. C’est la nouvelle la plus ouvertement imaginaire des trois. Le protagoniste principal a été disciple de Cornelius Agrippa, figure de l’ésotérisme des XVe et XVIe siècle. On retrouve autant dans ce récit le thème des amours contrariés [le personnage est épris d’une femme désormais d’un autre niveau social que lui] que celui du rapport à l’âge, voire au deuil. Car si la relation entre Winzy et Bertha peut finalement se concrétiser, l’élixir qu’a absorbé celui-ci condamne leur union à moyenne échéance. Winzy incarne un personnage sur lequel le temps passe, incapable de savoir quelle sera sa propre longévité. La présence d’Agrippa — une figure déjà importance dans Frankenstein, car une des sources des recherches du docteur — est également intéressante, offrant à Mary Shelley de convoquer à nouveau l’idée d’une immortalité artificielle, d’origine [pseudo] — scientifique. Le récit résonne enfin avec le Saint Léon (1799) de William Godwin, le père de l’autrice. On y retrouve en effet un personnage désargenté qui rentre en possession d’un élixir de longue vie. Lequel doit lui permettre de sortir de sa condition mais le mettra en fin de compte au ban de l’humanité.
Les trois textes qui composent ce recueil sont en réalité tirés d’une anthologie anglaise publiée quarante ans après le décès de Mary Shelley, en 1891 : Tales and Stories. Au vu de la qualité des trois récits proposés ici, il y a matière à regretter que son oeuvre soit si peu traduire en langue française, en dehors de Frankenstein, du Dernier Homme et de quelques nouvelles, de nombreux textes de l’autrice restent encore à faire découvrir de ce côté de la Manche. Même si l’ensemble de sa production ne relève pas du registre des littératures de l’imaginaire, ses histoires témoignent de la vie de la femme de lettres, de la place des femmes dans la société de son époque [c’est notamment le cas pour Mathilda, sorti en 1859]. Mais ils sont également marqués par la thématique du deuil, omniprésente dans son œuvre. A noter que ce recueil est une réédition du recueil L’Endeuillée et autres récits, publié chez Corti en 1993 et qui contenait un quatrième texte (ici absent) : « Transformation » (1831).